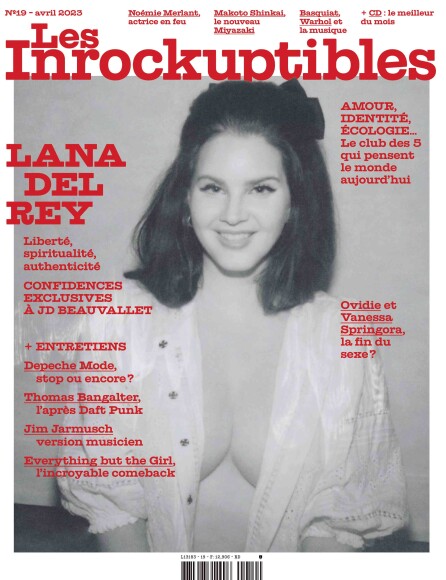A l’occasion de sa tournée française, Bashung, enfin porté sur la confidence, recolle les morceaux d’un passé refoulé. De l’enfance sévère à la maturité, l’envol d’une figure libre.
J’ai grandi chez ma grand-mère, en Alsace, et j’ai eu une jeunesse qui ressemblait à la télévision : c’était aseptisé, lisse, il y avait des tabous à ne pas transgresser. La fantaisie ne devait pas dépasser un certain degré généralement très bas. C’est dommage, parce que la fantaisie engendre souvent des idées fortes. Moi, je vivais dans un monde conservateur, plein de fausse sécurité, qui refusait d’envisager l’avenir, qui considérait le plaisir sensuel comme un péché. Toute cette trouille austère véhiculait forcément beaucoup d’hypocrisie. Je devais fermer ma gueule tant qu’on ne m’avait rien demandé. Peut-être qu’à l’époque d’autres parents pouvaient-ils parler plus simplement à leurs enfants.
Les rapports affectifs étaient-ils si lâches ?
Il n’y avait pas beaucoup de sentiments, on n’en parlait pas. Les gens travaillaient aux champs, ils ne discutaient pas beaucoup. On ne s’expliquait jamais, sauf en cas extrêmement grave, en cas d’accident. Et encore, on restait très vague, on effleurait les choses, les problèmes. On ne parlait qu’à coups de « Passe-moi le sel », toujours avec les mêmes mots. En même temps, curieusement, tout le monde avait la manie de hurler pour dire ces choses anodines. Parfois, nous étions quinze à table et cela dégageait une sorte d’hystérie permanente qui n’exprimait rien, même pas la colère, l’affrontement. Aujourd’hui, cette hystérie, c’est un peu ma bête noire. J’évite les gens qui ne savent s’exprimer que comme ça, j’en ai suffisamment entendu.
La vie était-elle essentiellement collective ?
J’avais des tantes, des oncles, d’un village à l’autre. Des tantes qui tombaient enceintes tous les ans. Quand les gosses atteignaient les 3-4 ans, on reconnaissait parfois chez eux les traits d’un mec qui habitait à l’autre bout du village et qu’on se mettait alors tous à appeler tonton. En entendant ça, le mari, lui, picolait… Et puis, ça sentait encore un peu Vichy, il y avait des souvenirs de dénonciation, des choses pas bien belles. C’était la vie à la campagne, la vie au grand air… Moi, je pensais qu’il devait forcément y avoir autre chose. Le plus terrible dans tout ça, c’était l’ennui. Qu’est-ce qu’on pouvait faire comme conneries à cause de ça ! On essayait de foutre le feu aux granges, ça ne rigolait pas c’est pour cela que le feu m’a longtemps fasciné, qu’il est souvent revenu dans mes textes, dans Pyromane, dans Je m’incendie volontaire… J’essayais, confusément, de faire contrepoids à une scolarité rectiligne j’étais parti pour être comptable, ma voie était tracée , à des rapports lourds, à des ambiances extrêmement pesantes à la maison. Il y avait ça, les conneries, et puis le sport, que je pratiquais un peu, qui me permettait aussi de m’aérer, de m’évader.
Dans ces conditions, comment ton intérêt pour la musique s’est-il développé, puis concrétisé ?
Au bout d’un moment quand même, la frustration a enclenché un moteur. Un fiancé de ma tante, un jour, a amené un violon à la maison. Il est reparti en laissant son instrument et ma grand-mère l’a rangé sur une armoire. J’avais envie de le voir, ce violon, de le toucher. Mais on me l’a toujours interdit. Le fiancé n’est jamais revenu et moi, je n’ai jamais touché au violon. Un instrument comme ça, dans un milieu un peu humble comme le nôtre, c’était un objet de luxe, il fallait qu’il reste en état. A ce moment-là, je ne comprenais pas encore que je pouvais me sauver par la musique. C’était encore du domaine du fantasme, du rêve. Alors c’est apparu peu à peu. Je me souviens qu’Elvis Presley est venu faire son service militaire en Allemagne. Je commençais à acheter des disques, il arrivait même qu’on m’en offre de temps en temps. C’est comme ça que j’ai entendu Buddy Holly, Gene Vincent, Vince Taylor et ça m’a laissé pantois. Chez moi aussi, d’ailleurs, ça a fait l’effet d’un tremblement de terre, mais pas pour les mêmes raisons… Je n’ai jamais trouvé cette musique superficielle, je l’ai prise au contraire très au sérieux. C’était à la fois fort, moderne, intelligent et simple, fulgurant et profond. Ça me laissait une chance, c’était à la portée de l’amateur. On sortait un peu du jazz, où il fallait vraiment s’accrocher, travailler énormément, ce que je ne pouvais pas me permettre. Avec le rock, c’était différent. Aujourd’hui, je suis vraiment heureux d’avoir débuté ainsi, par quelque chose de simple. Je crois que l’on mesure mieux la valeur des autres musiques lorsqu’on a commencé par accrocher au rock. On n’écoute plus les compositeurs classiques en se disant qu’ils ne sont bons que pour les enterrements nationaux. On se rend compte que ces types aussi étaient réellement fous. Dans l’éducation musicale que j’ai pu recevoir, on ne disait jamais que les musiciens du XIXème siècle étaient complètement cintrés.
Comment ton entourage a-t-il vécu ton engouement pour le rock ?
Il ne voyait la musique, la chanson, qu’à travers Ici Paris et France Dimanche. C’était superficiel, ça manquait de sérieux. Il n’y avait qu’Edith Piaf pour mettre tout le monde d’accord, sans qu’on sache vraiment pourquoi. D’une manière générale, ce qui était plaisir, sensualité, amour était considéré comme une perversité. Ces notions-là étaient bannies du vocabulaire. Je me suis rendu compte que si je n’avais pas par instant des moments de vrai plaisir, j’étais non seulement un homme triste, mais aussi un homme mort. J’ai découvert à ce moment-là que j’étais capable d’efforts incroyables, que je pouvais soulever des montagnes si, en bout de course, j’avais un seul rêve de plaisir. C’est une chance de pouvoir passer pour un pervers dans ces conditions. Cela dit, jouer de la musique, en Alsace, était impossible. Il n’y avait aucun marchand d’instruments dans le coin. On ne peut pas dire qu’on manquait de locaux, on aurait pu répéter dans n’importe quelle grange.
Ton départ d’Alsace et ton arrivée à Paris ont dû précipiter les événements.
Je me suis retrouvé à Paris vers l’âge de 12 ans en 1959, où je devais mener des études de comptabilité. A côté de ça, j’ai commencé à jouer dans de petits groupes. A 13 ans déjà, je m’étais payé un ampli. On manquait un peu d’argent pour s’acheter des Fender, des Vox, du matériel électrique. Alors, avec des copains de classe, on chantait des trucs de Hank Williams ou de Hugues Aufray, avec des instruments acoustiques, du banjo. Ça devait sonner comme les Pogues… Ensuite, nous faisions des petites premières parties dans les comités d’entreprise de Renault, dans les locaux qui servaient aux réunions syndicales. On reprenait les Sputniks, des choses comme ça. Un jour, je me suis retrouvé en première partie de Boby Lapointe. Je le trouvais incroyable, ce mec qui se dandinait d’un pied sur l’autre sur l’estrade. Je crois que ça passait au-dessus de la tête de tout le monde, mais j’étais fasciné par ce qu’il pouvait dégager.
Entrais-tu pour la première fois dans le monde du spectacle et des arts ?
Mes tout premiers contacts à l’âge de 13-14 ans, je les ai eus avec des peintres qui ne devaient peindre que des poulbots. Mais on s’éclatait sans arrêt chez eux. A l’époque, je rencontrais les premiers homosexuels. Je les appréciais, j’aimais leur manière de montrer qu’ils étaient mal acceptés par les autres. On écoutait beaucoup de jazz, Art Tatum, Thelonious Monk et puis Jerry Lee Lewis, les premiers Gainsbourg. Tous ces gens-là évoluaient dans un autre monde, étaient loin d’être des stars, mais étaient heureux. Je me souviens d’une femme qui avait une jambe de bois. Quand elle venait nous voir, elle la laissait à l’entrée. Ou bien, au restaurant, elle la posait sur la table, devant tout le monde. Forcément, ça me changeait de la lourdeur de chez moi.
Malgré tout, à 16 ans, tu as tout quitté Paris, les études, la famille pour tenter d’entamer une carrière de musicien.
C’était salutaire. J’ai toujours fonctionné ainsi : quand on se sent vide, que l’on ne peut plus rien donner, je crois qu’il faut savoir repenser à soi, redevenir un peu égoïste. C’est notre seule chance de pouvoir redonner ensuite. Je ne sais pas comment font les autres, ceux qui préfèrent ne pas s’écouter. Ils craquent forcément à un moment donné. Je rencontre assez souvent des gens qui ont raté leur vocation : ils passent des soirées entières à en parler, à en pleurer, ou alors ils se suicident. On peut vivre épanoui si l’on évalue bien la distance à parcourir entre ses propres rêves et la banalité du quotidien. Moi, j’ai découvert à un moment que l’on pouvait gagner sa vie en jouant de la musique. J’étais en vacances à Royan, j’ai rencontré des mecs et on s’est retrouvés à jouer quatre-cinq heures par jour dans une brasserie, sur la côte. Plus tard, on a rencontré un manager qui nous faisait jouer à Pigalle, dans les cabarets, les boîtes de strip-tease. J’ai gagné de quoi m’acheter un vélomoteur et une guitare électrique, c’était un début. On a ensuite fait le tour des bases américaines. On croisait des sous-Four Tops fabuleux, des musiciens country avec violons et pedal-steel. On en profitait pour acheter des Levis, des Zippo, des disques pas chers. Ça a duré comme ça deux ou trois ans avant que je ne commence à enregistrer mes premiers disques vers la fin des années 60.
J’imagine que le monde de la musique t’a révélé ses propres conventions, ses propres blocages.
Je débarquais avec énormément de choses en tête, avec tout ce que j’avais aimé. Je me heurtais soudain à des gens qui me disaient « Voilà : il faut jouer ça, il faut chanter ça, voici le studio, voilà le contrat. » C’était catastrophique, je ne comprenais pas qu’on puisse s’acharner à perpétuer des médiocrités le « Oser » de Osez Joséphine, ce n’est pas pour rien. Je retrouvais le climat de mon enfance, la même impossibilité de prendre des risques. Moi-même, j’étais loin d’avoir dissipé mes propres doutes. J’avais autant d’obstacles intérieurs qu’extérieurs à combattre. Je devais être honnête, accepter mes lacunes, les détourner, dépasser le stade du fan. J’avais presque l’impression d’avoir à régler un problème économique. Je voyais tous ces imports américains ou anglais qui nous submergeaient et nous, les Français, qui ne tentions même pas d’atteindre leur niveau avec nos propres préoccupations. Quand j’étais gamin, j’entendais Kurt Weill, j’ai baigné là-dedans, dans ces dissonances qui semblaient raconter le masochisme européen ce masochisme contre lequel j’ai toujours voulu lutter. Aujourd’hui, quand je fais passer une guitare dans l’écho, c’est pour illustrer cette idée d’ouverture, de grands espaces. L’Amérique en elle-même, je m’en fous totalement.
A cette époque, as-tu pensé abandonner ?
J’ai vécu de vrais moments de découragement. Lorsque j’avais 22 ans, un producteur a voulu me lancer comme le Tom Jones français. Heureusement, ça n’a pas fonctionné. Mais c’est toujours dans ces périodes-là, quand j’étais acculé, que je trouvais les moyens de remonter je ne pouvais pas aller plus bas. Le plus pénible, c’était la solitude. J’étais coincé entre une forme de conformisme et un snobisme aigu, froid, sans fondement, qui ne valait pas mieux. Le petit espace où j’aurais pu naviguer n’existait pas. On était plusieurs dans le même cas. La tentation était de former un club de solitaires, où on aurait tous été ravis d’aller mal. Il y avait beaucoup de types comme ça qui géraient leur échec. Je ne voulais pas me féliciter d’avoir perdu, de ce côté morbide qui frise la lâcheté. Je préférais utiliser ma force de désespoir, la canaliser comme une énergie. Je me suis dit qu’il fallait quand même que je tente de m’exprimer comme je le voulais, ne serait-ce qu’une fois, même pour la dernière fois. C’est là que tout s’est éclairé.
Au début des années 80, tu as percé soudainement avec des chansons comme Gaby et Vertige de l’amour, qui ne te ressemblaient pas forcément.
J’ai toujours aimé les musiciens qui ont un sens de l’humour, un recul créatif. A ce moment-là, je crois que je représentais et que je détruisais à la fois la tradition du rock. Je vivais intensément les choses que j’écrivais, des textes comme Toujours sur la ligne blanche. Sur scène, je pouvais revendiquer le suicide, l’amour extrême. Je vivais tout ça au premier degré et, en même temps, quelqu’un en moi regardait ça de loin. Ce personnage-là, celui de Vertige de l’amour, de Gaby, a pris à cette époque une importance de plus en plus grande. C’était à la fois dangereux parce que tout ça m’échappait un peu et jouissif parce que ça emmerdait les rockers conventionnels. Mais tout cela m’aidait à me trouver, à progresser.
La musique t’a-t-elle aidé dans tes rapports avec les autres ?
La musique m’a permis de nouer des rapports passionnels avec des gens. C’était bien à cela que je rêvais étant gosse : avoir des émotions fortes, me sentir vivre. Dans le même temps, j’ai aussi appris à côtoyer le fin fond de la connerie. Une chose que Gainsbourg m’a enseignée : la rigueur dans le travail, mais aussi dans les rapports humains. A côté de ça, je n’éprouve pas forcément le besoin de parler beaucoup. Avec les musiciens qui viennent jouer sur mes disques, on échange des choses très fortes sans prononcer un mot.
Dans ta manière d’écrire, on sent que tu n’es pas naturellement porté à t’exhiber.
Quand j’ai débuté, j’étais fasciné par les textes anglais. Je me demandais comment l’auditeur pouvait avoir le sentiment que les chansons lui appartiennent sans qu’il les comprenne vraiment. C’est ce que j’ai recherché : être à la fois juste et vague. Quand j’ai commencé à mélanger ces images, ces impressions, les gens me disaient « Ça a l’air obscur, hermétique. » C’était justement pour être précis que je faisais ça, je voulais raconter le fond des choses, ce qui vient du ventre, qui passe par la tête et le coeur. On vit une époque compliquée, je raconte cette complexité, ça n’a rien à voir avec l’envie de se cacher. Le doute qui est arrivé dans les années 80 ne doit pas seulement nous déstabiliser, mais doit nous apporter quelque chose. Je crois que l’on peut avoir des doutes intéressants. Ce n’est pas forcément dans les mots eux-mêmes que je trouve cette peinture des sentiments, c’est dans leur mariage, dans le contexte. Beaucoup d’artistes ont envie de commenter poétiquement les rapports humains. L’important, c’est quand même le style, la particularité. Après, sur scène, le public voit bien que je peux passer du plus doux au plus violent.
Tes derniers textes sont parfois à la limite du nébuleux.
J’ai toujours préféré ça à n’importe quelle explication cartésienne à laquelle il manquera toujours quelque chose. J’ai abandonné, par exemple, les sujets qui touchaient au militantisme je n’ai pas su trouver les mots. A l’époque de Touche pas à mon pote, j’ai eu l’impression que plus je dénonçais le racisme, plus il se développait. Le documentaire, c’est un autre métier. Je préfère encore les fables, avec des symboles, comme pour les enfants. Plus carré, ça ne serait pas moi. De toute façon, un mot peut suffire. J’écris « osez » et je l’entends, je le vois partout, dans tous les journaux. Est-ce qu’on va seulement le répéter ou vraiment l’appliquer ? Ce qui est drôle, c’est que ça vienne du mec le plus timide, le plus réservé qui soit. Ça m’aide beaucoup, ce rapport qui n’est pas forcément direct, ça me libère. Je me découvre en même temps que le public me découvre. Du coup, les gens n’attendent pas de moi que je me cantonne à un seul registre. Demain, je peux faire du symphonique, si je veux. Je suis très satisfait de la manière dont le public me prend. Il me laisse une grande liberté. Il y a quinze ans, chanter Madame rêve sur scène m’aurait valu une pluie de canettes.
Comment vis-tu ta reconnaissance actuelle ? Te rassure-t-elle totalement ?
Les moments d’écriture restent assez éprouvants, ils me replongent dans un état d’esprit antérieur à mes premières réussites, quand il ne se passait encore rien pour moi. Je ne m’assois pas encore à mon bureau en me disant « Je suis une star et je vais écrire une chanson. » Je me laisse aller à des réflexions qui me déstabilisent profondément. Cette vision du côté éphémère des choses et de leur importance, ça ne me quitte jamais tout à fait. Je vis avec une insatisfaction permanente qui m’oblige à revenir sur tout. Si je vivais tout ça de manière moins compliquée, avec une fausse sérénité, ça ne me ressemblerait pas. La manière dont j’ai été élevé m’a laissé ces traces-là.
Aujourd’hui, as-tu la sensation d’être revenu de loin ?
Disons que j’ai souvent retourné la situation. J’apprécie la vie différemment. Je me sens plus frais que beaucoup de gens qui semblent avoir définitivement banalisé un processus de renoncement. J’essaie de communiquer ça, petit à petit, de le distiller dans mes disques. Je me sens parfois comme au retour d’un voyage très lointain, comme lorsque je suis revenu récemment d’un tournage en Chine : il est difficile de transmettre ses impressions. Quand j’ai commencé, je me sentais un peu investi de cette mission. C’est important, finalement, cet état d’esprit. Sans ça, les contradictions, les fatigues sentimentales, les coups tordus, je ne les aurais pas supportés.
Richard Robert